Licencier tôt ou tard : that is the question...
- Lionel Labourdette
- 28 sept. 2025
- 10 min de lecture
Dernière mise à jour : 29 sept. 2025
Lionel Labourdette, PhD - Analyste Financier

Une société biotech a pour objet le développement d'innovations thérapeutiques. L'intensité capitalistique de l'industrie pharmaceutique rend indispensable des alliances stratégiques avec des laboratoires qui auront la capacité d'en exploiter le potentiel commercial. Le timing pour la signature d'un deal est donc un sujet clé. Tôt ou tard, les conséquences pour la société en matière de création de valeur mais également de risque sont très différentes. Nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à cette question en analysant les deux situations.
Nous avons évoqué dans un article récent la position des laboratoires qui semblent préférer en 2025 faire des paris technologiques (acquérir les droits sur une innovation « tôt » sur la base de données précliniques ou de Phase I) ou préférer à l'inverse la « sécurité », quitte à payer très cher, en achetant les droits d’innovations thérapeutiques ayant déjà fait une grande partie du marathon clinique, voire réglementaire (Phase III finalisée ou plus tard).
Si l’on se place maintenant du côté de la société innovante qui cherche un partenaire, la décision du moment idéal pour licencier un produit est très délicate car plusieurs options sont possibles, associées à des prises de risque différentes. La stratégie retenue conditionnera l’activité et la performance boursière, que ce soit en cas de succès mais également en cas d’échec.
1- Rappels utiles
Un développement long et séquentiel
Développer une innovation thérapeutique (petite molécule chimique ou produit issu des biotechnologies) impose le respect d’un plan rigoureux, validé par les autorités réglementaires (FDA, EMA,…). Les étapes cliniques doivent être passées de façon séquentielle expliquant le délai très long entre la découverte et la mise sur le marché (souvent > 10-12 ans).
Plus le produit avance dans les essais cliniques, plus ses effets sur l’organisme sont documentés (tolérance, efficacité pour l'indication visée, effets secondaires éventuels). Une dose optimale est définie et sera appliquée lors des essais menés pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché (AMM). Cette dose sera en général la base de référence pour les futures prescriptions. Avec le franchissement des diverses étapes, la probabilité de succès augmente pour atteindre 100% le jour de l’AMM. Le schéma ci-après est une représentation simplifiée du processus séquentiel du développement d'une innovation thérapeutique.
Evolution de la probabilité de succès en fonction du stade d'avancement

Source : FDA, Biomed Impact
Attention, la probabilité de succès évoquée plus haut concerne les aspects « réglementaires », le succès « commercial » dépendra d’autres facteurs (environnement concurrentiel et capacité à se différencier) et de décisions stratégiques quant aux modalités de commercialisation (seul ou en partenariat, prix de vente et de remboursement, etc.).
Beaucoup d'appelés et peu d'élus : une réalité à ne pas oublier
L'industrie pharmaceutique est connue pour son environnement réglementaire particulièrement rigoureux. Les exigences sont importantes pour accorder une autorisation de mise sur le marché, que ce soit en matière d'efficacité thérapeutique mais également pour tout ce qui concerne la sécurité du produit (tolérance, toxicité, caractérisation des effets secondaires, etc.).
Il résulte de ce processus sélectif un faible nombre de produits approuvés chaque année comme en témoigne le graphe ci-après (2025 s'inscrit dans cette statistique, avec 31 approbations délivrées fin septembre).
En toute logique et au regard des milliers de programmes R&D en cours, les échecs seront bien plus nombreux que les succès. Le management d'une société, s'il doit évidemment croire en ses innovations, a le devoir d'anticiper un possible scenario négatif et garantir la pérennité de la société.
Nombre d'approbations délivrées annuellement par la FDA aux Etats-Unis

Source : FDA, Biomed Impact
La valeur du projet croît en fonction des avancées cliniques
Lors du franchissement d'une étape, la probabilité de succès augmente. Un palier de valeur est donc atteint suite à l'application dans le modèle de valorisation de la nouvelle probabilité de succès. Il existe un second facteur qui impacte la valeur du projet : le temps restant avant l'obtention de l'AMM. La valeur d'un projet étant définie comme la valeur actualisée des cash flow futurs (Valeur Nette Actualisée = VAN ou NPV en anglais), plus le délai est court moins l'impact de l'actualisation des flux futurs se fait sentir. Ceci explique que la VAN progresse de façon plus importante que la probabilité de succès. Le schéma ci-après reprend les hypothèses de modélisation développée plus loin.
Evolution de la valeur d'un projet en fonction du stade de développement (en MEUR).

Source : Biomed Impact
Modélisation de la VAN d'une innovation thérapeutique
Définir la valeur d'un projet est un exercice délicat. Il n'existe pas de modèle parfait et quelle que soit la méthode employée, la VAN résulte de l'application d'une longue série d'hypothèses qui peuvent laisser la place à de nombreuses discussions/objections. Ce qui importe avant tout, c'est la prise en compte des paramètres clés pouvant faire évoluer la VAN. Parmi eux, citons :
Le calendrier prévisionnel des développements qui doit être le plus réaliste possible
Les coûts des développements cohérents avec la sphère thérapeutique
Un prix de vente comparable à celui des traitements standards
Un nombre de patients traités annuellement raisonnable au regard de la population adressée et de la concurrence en place
Une vitesse de pénétration du marché qui soit en phase avec le modèle économique retenu et l'offre existante
Un pic des ventes cohérent avec les ventes annuelles des concurrents établis
Une durée de vie du brevet qui soit en phase avec l'état de l'art (nombre d'années de protection restants avant la concurrence de génériques/biosimilaires)
Des probabilités de succès en ligne avec celles observées dans l'industrie
Un taux d'actualisation des flux futurs qui tienne compte du risque associé à la technologie et sa maturité mais également qui soit adapté en fonction du profil de risque de la société.
Le modèle que nous présentons ci-après est une version simplifiée qui permet néanmoins de donner une vision assez objective de la valeur d'un projet qui est financé "de A à Z" par la société = de la recherche à la commercialisation. Le modèle intègre donc des frais à partir de la commercialisation (coûts de production estimé à 20% du Chiffre d'Affaires, marketing de 15% du CA et des frais généraux de 2%). Il tient par ailleurs compte d'une fiscalité d'entreprise (taux d'imposition fixé à 25%).
La valeur du projet est logiquement faible au regard de l'état de l'art = démarrage du projet qui est encore au stade de la Recherche (concept précoce qui doit ensuite être validé sur des modèles précliniques avant d'entrée dans les phases cliniques). La probabilité de succès retenue est de 1%. Nous avons choisi un produit à potentiel de blockbuster, prescrit à 50 000 patients au pic des ventes, avec un prix moyen de 25 000 euros (aucune inflation, pas de hausse de prix). L'AMM est obtenue au bout de 12 ans, la propriété intellectuelle, déposée au début du programme, arrive à échéance à l'année 20.
Modèle théorique simplifié de calcul de la Valeur Actuelle Nette d'un projet (en MEUR)

Source : Biomed Impact
2- Partenariat : un impact majeur sur la valeur du projet
Développer, valider, approuver et vendre une innovation thérapeutique impose la maîtrise de l'intégralité de la chaîne de valeur. Au-delà des investissements R&D conséquents (285 MEUR dans notre exemple), la société doit disposer des compétences clés à chaque niveau, que ce soit à la R&D, en production industrielle ou sur le terrain (forces de ventes). La plupart des sociétés biotech ne disposent pas des ressources financières ni de la masse critique pour devenir une biopharma pérenne. Elles restent donc sur la partie amont de la chaîne de valeur (Recherche et Développement clinique). Elles doivent ensuite passer le relais à un partenaire qui assumera les essais cliniques tardifs puis la commercialisation.
Plus le deal sera signé tard, plus la valeur du projet sera importante. La société sera en effet en mesure de négocier des paiements d'étape plus élevés, des taux de royalties sur les ventes également plus favorables. Par souci de simplification, notre modèle intègre un taux fixe de royalties. Dans la plupart des deals, des tranches de chiffre d'affaires sont définies auxquelles sont appliquées des taux progressifs. Cela permet au laboratoire partenaire de préserver un retour sur ses investissement (frais de R&D des essais cliniques tardifs) et de ne rémunérer la société biotech qu'en cas de succès.
Le tableau ci-après résume les principales hypothèses et résultats obtenus dans 5 situations de signature de partenariats (de tôt à très tard).
Signature d'un deal à divers stades de développement et Valeur Actuelle Nette d'un projet (en MEUR).

Source : Biomed Impact
Il ressort logiquement une hausse de la valeur du projet en fonction de son avancement. Le grand saut de valeur se situe à la Phase III (données considérées comme positives et suffisantes pour le dépôt du dossier d'enregistrement). Cette différence n'est pas étonnante car le risque "clinique" est à ce stade quasi-inexistant.
La modélisation ci-après détaille les 5 scenarii décrits plus haut et met en évidence les flux annuels :
sortants : R&D investie (en rouge)
entrants : paiement d'étapes (en vert) et royalties (en jaune)
Pour une meilleure lecture/comparaison, des échelles identiques ont été appliquées aux graphes. L'échelle retenue ne permet cependant pas de visualiser les investissements R&D en Pré-Clinique ni pour la Phase I.
Flux investis et flux perçus (en MEUR)



Source : Biomed Impact
Visuellement, les différences sont assez nettes. Plus le produit est licencié à un stade tardif, plus les paiements d'étape (signature + milestones) sont élevés. Le taux de royalties étant plus élevés, le flux résultats des ventes faites par le partenaire sont bien plus importants que pour des stades plus précoces.
3- Existe-t-il un timing idéal pour licencier ?
Tôt ou tard, le choix est cornélien. Il alimente souvent des débats passionnés au sein de Conseil d'Administration et entre actionnaires. Création de valeur à court ou à moyen/long terme, prise de risque versus sécurisation de l'activité sont autant de sujets sensibles sur lesquels les avis peuvent diverger en fonction des objectifs de l'investissement de chacun.
Chacune des options a des avantages mais également des inconvénients (ou limites) que nous avons essayé de lister dans les tableaux ci-après.


Source : Biomed Impact
Les "notations" proposées résultent d'une réflexion qui nous est personnelle mais elle est également et surtout le fruit de l'analyse de plus de 2 décennies d'histoires boursières de sociétés de l'univers Biotech/Medtech FR.
Certains préfèreront le risque auquel est associé un retour sur investissement plus élevé mais l'expérience et l'histoire montrent que les scenarii "blue sky" sont rares et qu'il faut choisir les bons dossiers pour voir une création de valeur importante, contemporaine d'une évolution positive du cours de bourse. L'exemple récent d'Abivax a induit une euphorie et rappelé que de belles performances sont possibles. Il faut néanmoins rappeler que le cours d'Abivax avait atteint près de 35 EUR au printemps 2021 avant de voir une érosion lente vers des niveaux proches de 5 EUR en avril 2025, quelques semaines avant la publication des premières données de Phase III. Cette baisse trouve une explication possible dans l'absence de newsflow pendant de très longs mois (société mono-produit) mais aussi en raison des refinancements intermédiaires dilutifs ayant permis la finalisation de l'essai (période d'induction de l'étude). L'issue est heureuse avec l'annonce des données positives de cette phase III mais un échec aurait signifié la fin de la société. Il faut avouer que de tels scenarii "binaires" sont particulièrement inconfortables pour un investisseur.
Plusieurs exemples permettent d'illustrer les notations présentées (non exhaustif) :
Quantum Genomics : échec de la phase III du Firibastat dans l'hypertension artérielle menée en solo (société mono-produit). C'est l'inverse du scenario positif d'Abivax. La société est aujourd'hui proche de la liquidation.
Onxeo : échec de la phase III de Livatag dans le cancer du foie. Pas d'amélioration versus le traitement standard. Comme Quantum Genomics, chute brutale du cours et rebond très délicat à faire. La société (renommée Valerio Therapeutics) est aujourd'hui en situation très délicate.
Genfit : échec de la phase III d'Elafibranor dans la NASH. La société avait focalisée ses ressources sur cette étude et se trouvait en situation mono-produit. Par chance, une seconde indication pour cette molécule fut validée (cholangite biliaire primaire) et a permis de sauver l'histoire, au travers d'un partenariat avec Ipsen cette fois.
Inventiva : actuellement en phase III pour valider Lanifibranor dans la MASH (NASH), tous les programmes R&D ont été stoppés au profit de cette étude vaste et très coûteuse. Le dénouement se rapproche mais les refinancements successifs ont plongé le cours de bourse vers des plus bas début 2025. L'effet Abivax est indéniable depuis fin juillet mais le scenario reste binaire. L'histoire sera sans lendemains en cas d'échec ou d'infériorité par rapport aux premiers produits approuvés dans cette indication.
Medincell : en dépit de données de phase III positives (rispéridone à action longue dans la schizophrénie), un premier examen du dossier par la FDA s'est soldé en avril 2022 par une CRL (Complete Response Letter) nécessitant à Teva/Medincell de répondre à une liste de questions. L'incertitude sur le titre a induit un repli de -29% suite à cette lettre. L'approbation en mai 2025 a permis de rattraper cette contreperformance. La chance de Medincell fut d'avoir licencié tôt le produit et de pas être impacté financièrement (à l'exception du report d'un an du paiement d'un milestone et du décalage dans le temps des flux de futures royalties). Le risque du projet, transféré à Teva fut salvateur pour Medincell. La situation est en revanche totalement différente pour Gensight Biologics ou DBV technologies (phase III en solo), pénalisés par des retards réglementaires importants dont ils doivent assumer seuls les conséquences financières. Nicox avait également connu des déboires avec un retard dans l'approbation du Vyzutla (licencié à Bausch & Lomb) en raison de la non conformité d'un site industriel en Floride.
Novo Nordisk : société pourtant mature, success story européenne avec des revenus importants et un pipeline R&D d'excellente qualité, Novo Nordisk a connu en décembre 2024 un revers majeur dans un essai clinique de phase III (Cagrisema dans l'obésité) dont les résultats furent positifs mais inférieurs aux attentes. L'efficacité thérapeutique moyenne place le produit en position délicate par rapport aux concurrents. Le titre a chuté de près de 20% en séance.
4- Conclusion : pour l'investisseur, il faut rester cohérent avec sa stratégie d'investissement
L'investisseur ne maîtrise en général pas la stratégie adoptée par le management et/ou son Conseil d'Administration. Il "subit" donc les priorités définies par la société qui décide le timing de la signature d'un deal (dès lors que les données scientifiques et cliniques disponibles permettent d'envisager de trouver un partenaire). Prévoir une date est donc très délicat. Il faut donc suivre avec attention toutes les interventions du management (communiqués de presse, interviews, webinaires, etc) qui peuvent aider à clarifier le scenario choisi : tôt" ou "tard".
Investir dans les biotech/medtech relève d'un choix personnel dont les raisons/motivations varient d'un investisseur à l'autre.
Si la préférence est accordée à la prise de risque, aux scenarii binaires, alors les dossiers répondant au critère "d'explosivité" (en cas de succès) devront être privilégiés. L'investisseur devra alors construire son portefeuille avec des sociétés "tard".
A l'opposé, une approche de gestion en "bon père de famille", pour autant qu'elle puisse être possible dans le secteur biotech (!), doit mettre l'accent sur des dossiers au risque équilibré (plusieurs produits en développement), aux sociétés qui licencient "tôt" pour sécuriser la trésorerie et réduisent la probabilité de refinancements trop souvent dilutifs.
AVERTISSEMENT IMPORTANT : Toutes les données présentées dans ce document sont issues de sources réputées fiables mais dont l’exactitude ou la pertinence ne peuvent être garanties. Les informations et les avis exprimés dans ce document ne sont pas exhaustifs. Ce document n’est pas un élément contractuel ou commercial et ne constitue pas un conseil en investissement. La responsabilité de BIOMED IMPACT ne pourra donc être engagée quel que soit l’usage qui serait fait du présent document. BIOMED IMPACT attire l’attention du lecteur sur le fait que l’investissement dans le secteur Biotech/Medtech comporte des risques élevés et que les performances passées ne présagent pas des performances futures.


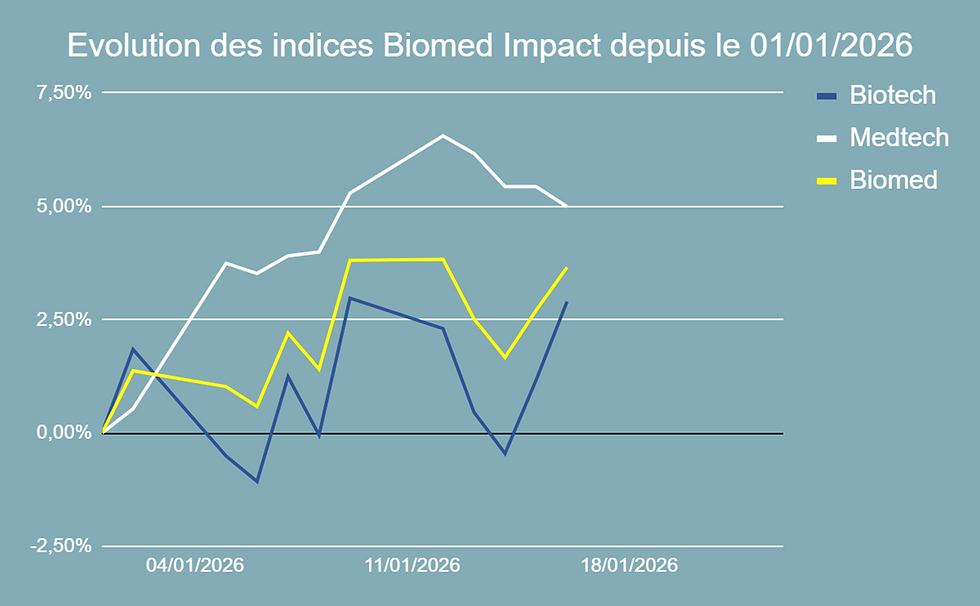
Commentaires